"Il est certain que les frontières jouent un rôle dans les conflits", affirment Jean-Baptiste Veber et David Périer dans leur livre "Tracer des frontières, dix histoires de cartes au cœur des conflits contemporains", paru en mai aux éditions Novice.
Dans cet ouvrage, les auteurs expliquent comment de simples tracés sur une carte, souvent imposés par les grandes puissances du moment, ont transformé des territoires en États, bouleversant la vie et le destin de peuples enracinés, brutalement séparés par des murs imaginaires.
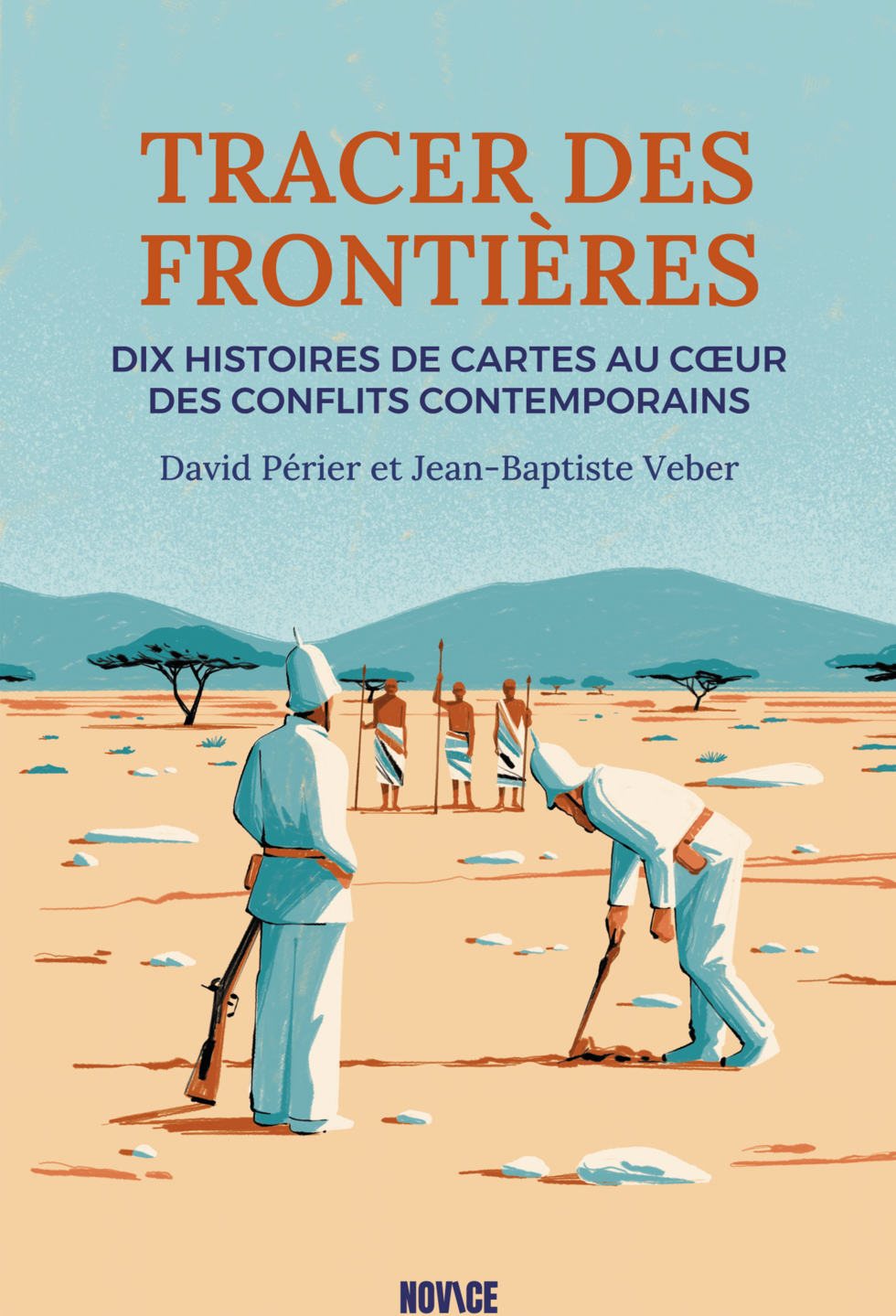
Ainsi, de l’Afrique à l’Asie, du Sahara occidental au labyrinthe Moyen-Oriental, de Cabinda, en Angola, à Kaliningrad, en Russie, les frontières ont tangué pour à peine se fixer, laissant l'impression de se figer dans le temps.
France 24 : les principaux conflits frontaliers dans le monde d'aujourd'hui sont-ils directement liés au tracé des frontières, dont l'origine remonte, selon votre ouvrage, à 1648 ?
Jean-Baptiste Veber : D’une certaine façon oui, les principaux conflits frontaliers sont liés aux principes des frontières établis lors du traité de Westphalie (1648). À l’époque, il s’agissait de rétablir la paix en Europe, après un siècle et demi de guerres de religions, en particulier la guerre de Trente ans, équivalente à une guerre mondiale en termes de traumatisme en Europe. On établit alors la logique des États confessionnels, reposant sur des limites précises, dont les territoires n’autorisent, en théorie, qu’une seule religion, pour éviter les conflits au sein d’un même pays.
À lire aussil'UE lance un nouveau système de contrôle automatisé aux frontières
De nos jours, la liberté religieuse ou même la laïcité font que les frontières renferment parfois un grand nombre de confessions. Avec les évolutions historiques (Révolution française, Printemps des peuples, décolonisation…), on est passé de la conception d’État confessionnel (il n’en reste que quelques-uns dans le monde) à celui d’État-nation – des territoires auxquels correspondent un peuple à l’identité et la culture plus ou moins plurielle. Les frontières nationales et territoriales sont l’un des principes fondamentaux de construction des sociétés modernes. Qui veut exercer le pouvoir doit posséder des frontières souveraines… Non seulement des peuples se battent pour cela mais d’autres entrent en conflit pour élargir leurs territoires.
Les raisons conflictuelles sont nombreuses : nationalismes, ressources, minorités (culturelles, religieuses, ethniques) irrédentisme… Il ne suffit pas des principes westphaliens [souveraineté, égalité, non ingérence, respect des frontières, diplomatie et équilibre des puissances, NDLR] pour faire des conflits et des guerres, le plus souvent ils fonctionnent bien pour partager les territoires – c’est pour cela qu’on les a conservés. Mais dans un certain nombre de situations, ils sont l’un des facteurs de conflits, car ils contraignent à un partage précis, rigide, empêchent la codirection ou la supranationalité, qui permettraient de transcender les affrontements. Codirection et supranationalité sont de nouveaux outils juridiques et géopolitiques qui se forgent au XXIe siècle, progressivement depuis le XXe siècle et surtout la mise en place du système international onusien. Ils sont un moyen de dépasser les principes westphaliens là où ils ne fonctionnent pas ou plus.
À lire aussiL'Arménie et l'Azerbaïdjan commencent la délimitation de leur frontière commune
Est-il exact d'affirmer que l'Europe est responsable du "saucissonnage" du continent africain ? Les États actuels ont-ils une responsabilité dans la persistance de leurs différends frontaliers ?
L’Europe est en partie responsable du partage du continent africain, dont les territoires sont qualifiés d’États-nation, ce qui est un concept parfois éloigné de la réalité, en raison du grand nombre d’ethnies, de la diversité religieuse, culturelle, linguistique ou de réalités politiques endogènes ayant survécu à la colonisation et qui s’ajoutent aux outils juridico-politiques européens héritées des décolonisations.
Les États africains ont une part importante dans les conflits actuels : certaines élites, certaines ethnies, certaines majorités ou minorités culturelles ou religieuses, se distinguent par une volonté d’affirmation qui contrarient les autres communautés présentes. Cette concurrence s’exerce dans le cadre des frontières léguées par les Européens, d’où l’idée pertinente, mais seulement en partie, que ces frontières sont aussi responsables des problèmes. Le néocolonialisme de certaines puissances, notamment pour l’exploitation des ressources, peut aussi jouer sur ces frontières. Il peut choisir un camp contre un autre, ce qui appuie encore le sentiment d’une responsabilité des anciens colonisateurs.
Pourtant, en analysant les ressorts des conflits actuels, il est évident que les États ont une responsabilité plus ou moins significative dans leur persistance – quels qu’en soient les motifs : accès aux ressources, nationalisme, expansion territoriale, prosélytisme culturel ou religieux… Les décolonisations remontent à près de trois-quarts de siècle. Les générations au pouvoir n’ont connu que l’indépendance ainsi que les frontières héritées de l’Histoire, considérées comme nationales et largement intégrées à la pratique du pouvoir. On constate qu’une majorité d’Africains y sont attachés et qu’ils imputent eux-mêmes largement les conflits frontaliers aux élites locales. Celles-ci instrumentalisent parfois le "mythe des frontières coloniales", selon les termes du géopolitologue Michel Foucher, pour détourner l’attention de leurs propres ambitions.
À lire aussiLe Venezuela et la Colombie entrouvrent leur frontière
Vous écrivez : "Les tensions entre le Maroc et l'Algérie proviennent d'une incompréhension et d'une non-acceptation de tracés anciens imposés par la force". Les tensions entre les deux voisins maghrébins ne sont-elles pas davantage liées au problème du Sahara occidental ?
Le problème du Sahara occidental découle d’un découpage administratif effectué durant la colonisation, ou plutôt peu ou pas effectué durant la colonisation, ce qui explique que lors des indépendances, dans cette région saharienne, le Maroc et l’Algérie n’ont pas pu reprendre, pour se partager la zone, le traçage des frontières coloniales. Ce fut le cas ailleurs dans la grande majorité des cas. La région est une zone de circulation de populations nomades, en plein désert où l’appropriation humaine est minimale et ceci depuis toujours.
Le colonisateur français n’établit pas de limite administrative claire entre ses colonies dans une région où il n’imaginait pas qu’elle serait un jour l’objet de revendications frontalières précises. À cette époque, on n’envisageait pas les différents facteurs qui motivent l’Algérie et le Maroc dans leur affrontement : affirmation d’un nationalisme de jeunes États indépendants, devenus puissances régionales et qui persistent donc dans leur volonté d’affirmation, ressources fossiles importantes, territoire avec façade maritime longue et bien positionnée, en plus de ressources halieutiques importantes. Voilà l’explication pour la "non-compréhension" de l’héritage de la domination coloniale.
Concernant l’idée d’une "non-acceptation", elle renvoie aux arguments des partis en présence, considérés de part et d’autre comme fallacieux ou illégitimes. Tandis que le Maroc fonde ses revendications sur les limites constitués par l’Empire almoravide au XIe siècle, l’État algérien s’érige en défenseur du peuple sahraoui, qui est intégré à la famille ethnique berbère, dont l’Algérie s’affirme le foyer – car c’est le pays maghrébin qui compte la plus grande superficie saharienne. Ces arguments revêtent une dimension opportuniste de part et d’autre, que se refusent à accepter et comprendre les belligérants, car ce serait la première étape d’une renonciation à la revendication de souveraineté territoriale. Vu d’Europe, on ne mesure sans doute pas non plus assez comment il existe une rivalité pluriséculaire entre le Maroc et l’Algérie ou les États qui constituaient avant la colonisation la souveraineté politique de cette partie de l’Afrique du Nord.
À lire aussiTensions entre le Liban et Israël autour du gaz offshore
Le Proche et Moyen-Orient sont souvent décrits, sans doute à juste titre, comme une poudrière. Le tracé des frontières explique-t-il tout dans les soubresauts récurrents dans cette région ?
Le tracé des frontières au Proche et au Moyen-Orient, en réunissant des peuples concurrents, des cultures et des religions différentes, peuvent parfois constituer un argument dans le déclenchement de conflits contemporains. C’est le partage d’une région auparavant uniformément dominée par le despotisme ottoman, qui a pu être à l’origine d’une multiplication des conflits pour la prise du pouvoir. Cet argument était cependant beaucoup plus valable au temps des décolonisations, il y a trois-quarts de siècle, mais comme expliqué pour l’Afrique, les pouvoirs, élites, religions et idéologies locales ont aussi une responsabilité importante sinon majeure dans les conflits.
De même qu’en Afrique, les frontières coloniales, comme celles de la Jordanie, par exemple, sont largement acceptées par les populations, et même devenues objet d’orgueil national. Le conflit israélo-palestinien trouve ses arguments dans des périodes historiques largement antérieures à la colonisation. La non-reconnaissance d’un État kurde, comme nous l’expliquons, est dû au fait que dès la fin de la Première Guerre mondiale, la Turquie conserve un poids géopolitique majeur, qui lui permet de peser d’ores et déjà dans le partage, même en tant que pays vaincu. On le voit aujourd’hui dans l’interventionnisme du président turc Recep Tayyip Erdogan durant la guerre civile syrienne.
À partir des années 1960, le parti Baas acquiert une importance décisive dans la région et le soutien de l’URSS explique beaucoup de dérives nationalistes aboutissant à des guerres, notamment originaires d’Irak (contre l’Iran, contre le Koweït).
De plus, dès les années 1960, plus encore 1970, la richesse pétrolière et gazière donne à certains acteurs, singulièrement l’Arabie saoudite, un poids géopolitique qui les rend presque autonomes des puissances dites néocoloniales, du moins dans la région. Aujourd’hui, au moins à égalité sinon davantage que les anciennes puissances coloniales (restées de grandes puissances diplomatiques et les États-Unis, bien sûr), ils jouent une partie d’échecs géopolitiques, dans laquelle ils sont presque complètement maîtres du choix de leurs pièces.
Il est certain que les frontières jouent un rôle dans les conflits, elles sont un "terrain de jeu géopolitique" sur lequel s’expriment et cherchent à s’imposer différents acteurs. Mais c’est l’attitude de ces derniers qui est vraiment décisive pour expliquer la nature des conflits et leur entrevoir une issue – ou aucune. Certains conflits semblent inexpiables mais ce n’est pas la faute des tracés originels, bien davantage celles des acteurs incapables de compromis. Car l’Histoire et les limites entre souverainetés, avant comme après Westphalie, sont toujours faites de compromis. La "loi du plus fort" n’est qu’une dimension des compromis, aucun empire n’a jamais réussi à s’imposer complètement, a fortiori aucun État-nation, tenu en principe de respecter le droit international.
À lire aussiLa justice internationale accorde à la Somalie une zone maritime revendiquée par le Kenya
Concernant les litiges maritimes, vous qualifiez le contexte entre la Chine et ses voisins d'explosif. Pour quelles raisons ?
Nous signalons une présence militaire américaine importante sur le pourtour oriental de la mer d’Asie méridionale (bases militaires, flottes), qui s’appuie largement sur la collaboration des rivaux de la Chine, en échange de "business" divers. Si la zone est hautement stratégique pour la Chine, notamment d’un point de vue commercial, elle l’est aussi pour les Américains. En outre, les ZEE - Zones économiques exclusives, dans le droit de la mer - étant des souverainetés d’ordre économique, cela n’empêche pas d’envoyer dans les zones à distance des côtes des navires militaires patrouiller pour faire respecter le droit international, veiller à la libre-circulation et/ou lutter contre les problèmes de piraterie, ce que ne se privent pas de faire les Américains. Il est arrivé récemment à un navire français de se déployer dans la zone pour y défendre le respect du droit international : il a été d’ailleurs escorté vers la "sortie", le détroit au sud de la mer, par une escadre de la marine chinoise envoyée à sa rencontre.
Le point majeur de cette poudrière maritime est la présence de Taiwan sur sa limite septentrionale, l’île et le canal la séparant de la Chine continentale marquant en quelque sorte le passage de la mer de Chine du Sud (mer d’Asie méridionale) à celle de la mer de Chine du Nord (mer Jaune). Le terme "explosif" renvoie à l’idée que si un affrontement, de quelque ampleur que ce soit, devait se produire, ce serait probablement, en priorité et à tout le moins au début (en fonction de l’ampleur de l’affrontement) dans cette zone. C’est ici que la Chine concentre le plus ses investissements militaires maritimes, sans compter les bases navales construites, parfois sur des récifs plutôt qualifiés de rochers mais qui deviennent grâce à leur terre-plein des îles, d’où ils peuvent réclamer une extension de leur ZEE.
À l’examen d’une carte des implantations militaires sino-américaines, il est frappant de voir comme se font face à travers de multiples bases les deux grandes puissances, sans compter les espaces tenus et défendus par les autres puissances. Il s’agit d’un "point chaud" des mers mondiales, à la fois en raison de son importance économico-commerciale que des moyens militaires mis face à face et de la tension quasi-constante autour de l’île de Taïwan. Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si, mais plutôt quand Taïwan sera victime d’une tentative de (re)annexion – qui ne sera pas forcément totalement militaire. Il s’agit en effet d’une démocratie ce qui laisse ouverte la possibilité d’une évolution par les urnes, très improbable cependant aujourd’hui. Face à cela les États-Unis, comme les voisins de la Chine, ne resteront pas passifs.